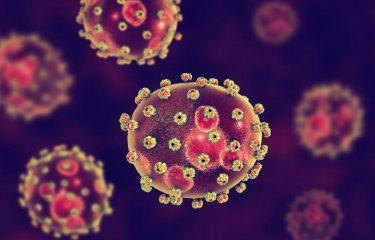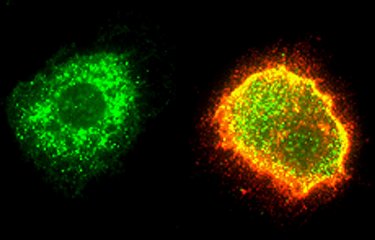Mise à jour - Août 2024
Quelles sont les causes ?
Le virus de Lassa est transmis par le rat du Natal (petit rongeur appelé Mastomys natalensis), un rongeur commun en Afrique de l'Ouest. Le virus se trouve dans l'urine ou les fèces du rongeur et peut infecter les humains par contact direct, par ingestion de nourriture contaminée, ou par inhalation de poussière en suspension dans l'air.
Comment se transmet le virus ?
La transmission du virus de Lassa peut se faire de plusieurs manières :
- Directement à l’être humain, par contact avec les excréments ou l'urine de rongeurs Mastomys infectés ; un grand nombre de ces rongeurs vivent à proximité, voire à l’intérieur des habitations, et leur taux d’infection peut aller jusqu’à 80%.
- Indirectement :
- par la consommation d'aliments contaminés ;
- la transmission par l’air n’a pas été observée.
La transmission interhumaine est également possible, mais est moins fréquente, survenant principalement dans des environnements de soins de santé sans mesures de contrôle des infections adéquates (matériel médical contaminé), mais également par voie sexuelle et par contact direct avec les liquides et sécrétions humaines.
Le virus Lassa doit son nom à la ville du Nigeria où il a été isolé pour la première fois en 1969 chez une infirmière tombée malade après avoir prodigué des soins, et qui en mourut, après avoir contaminé deux autres personnels soignants.
Quels sont les symptômes ?
Le tableau clinique de la fièvre de Lassa est variable. Dans un grand nombre de cas, elle est asymptomatique. La durée d’incubation est de 2 à 21 jours après l’infection.
Lorsque la maladie est symptomatique, des signes cliniques peu spécifiques sont observés : fièvre, vomissements, nausées, douleurs abdominales, céphalées, douleurs musculaires (myalgies), douleurs articulaires (arthralgies), fatigue intense (asthénie).
Dans les cas sévères, les symptômes s’aggravent ensuite, avec l’apparition d’œdèmes, de signes hémorragiques, d’épanchements péricardiques et pleuraux, et plus rarement d’encéphalites.
Le patient décède dans un contexte de choc hypotensif (tension artérielle très faible) et hypovolémique (insuffisance de sang ou liquide dans les vaisseaux sanguins), et de défaillances rénale et hépatique environ 14 jours après l’apparition des symptômes.
La fièvre de Lassa est d’une plus grande gravité pour la femme enceinte, conduisant plus fréquemment au décès de la mère et très souvent à celui du fœtus.
Chez les patients qui survivent à l’infection, la fièvre disparait environ 10 jours après le début des symptômes, mais grande fatigue, malaise et vertiges peuvent persister plusieurs semaines. Certains de ces patients présentent de graves séquelles : surdité uni ou bilatérale, temporaire ou définitive, et myocardite (inflammation et lésions du muscle cardiaque).
À LIRE AUSSI
Comment diagnostiquer la maladie ?
Il est difficile de distinguer la fièvre de Lassa par rapport à d’autres fièvres hémorragiques virales de types Ebola ou fièvre jaune, au paludisme ou à la leptospirose…
Étant donné la nature contagieuse du virus, des tests doivent être réalisés dans des conditions de biosécurité strictes. Le diagnostic se fait dans des laboratoires de référence. Les tests utilisés sont des tests sérologiques pour identifier les anticorps spécifiques, la RT-PCR qui détecte le matériel génétique du virus, l’isolement du virus par culture cellulaire.
Quels sont les traitements ?
Il n’existe à ce jour qu’une seule molécule utilisée contre le virus Lassa. Il s’agit de la ribavirine, un antiviral à large spectre contre les virus à ARN utilisé en particulier pour le traitement de l’hépatite C.
Malheureusement, ce traitement ne représente pas une solution satisfaisante au problème que pose la fièvre de Lassa dans les pays endémiques : son efficacité reste assez peu démontrée et elle doit être administrée très tôt après l’infection. Or les signes cliniques du début de la maladie sont similaires à ceux observés pour d’autres pathologies, comme le paludisme ou la dysenterie, très fréquentes dans ces zones du globe. L’implication du virus Lassa n’est donc souvent envisagée que plusieurs jours après l’apparition des symptômes, et la ribavirine, dans les rares cas où elle est disponible sur le terrain, est le plus souvent administrée trop tardivement pour être efficace.
Le traitement des symptômes inclut la réhydratation, le traitement de la douleur et la gestion des complications hémorragiques. Une prise en charge rapide et efficace est cruciale pour améliorer les chances de survie.
Il n’existe aucun vaccin à ce jour.
Comment prévenir la maladie ?
Pour prévenir la fièvre de Lassa, une bonne hygiène est importante : conserver ses aliments dans des contenants résistants aux rongeurs, maintenir son logement propre. Il faut également éviter le contact avec les excrétions de rongeurs.
La sensibilisation des communautés aux modes de transmission et l'adoption de pratiques sûres de préparation de la nourriture sont également essentielles.
En milieu médical, le personnel doit prendre des précautions d’hygiène et de sécurité de lutte anti-infectieuse : masque, gant, blouse, vêtements couvrants.
Pour les voyageurs revenant d’Afrique occidentale, un diagnostic chez des personnes fébriles doit se faire notamment s’ils ont voyagé dans les zones où la fièvre de Lassa est endémique.
Combien de personnes touchées ?
Chaque année, on estime que de 100 000 à 300 000 cas de fièvre de Lassa surviennent en Afrique de l'Ouest, avec environ 5 000 décès. Cependant, beaucoup de cas ne sont pas rapportés en raison de l'accès limité aux soins de santé et des symptômes non spécifiques dans les cas légers.
Les personnes les plus exposés sont celles qui habitent dans les zones rurales où vivent les rats Mastomys. La fièvre de Lassa est endémique au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, où des flambées épidémiques surviennent régulièrement.
Pour aller plus loin :