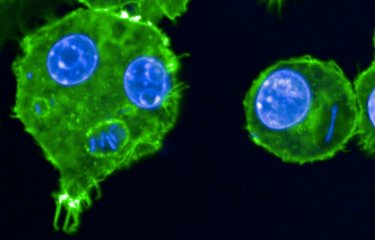Un nouveau modèle permet aujourd’hui de mieux comprendre la dynamique saisonnière de la peste à Madagascar. Une maladie toujours endémique dans cette région, émergeant le plus souvent entre octobre et mars. Issue d’une collaboration entre les Instituts Pasteur de Paris et de Madagascar, cette étude ouvre des perspectives pour le développement de stratégies de lutte et de prévention plus efficaces en s’appuyant sur une approche One Health, essentielle pour limiter la résurgence de cette maladie.
Si elle a disparu en Europe, la peste continue de circuler dans plusieurs régions du monde. C’est le cas par exemple chaque année à Madagascar, avec des centaines de cas, particulièrement dans les hautes terres rurales. La maladie, transmise en grande majorité par les puces de rats, engendre des flambées saisonnières le plus souvent entre octobre et mars, posant un défi constant aux autorités sanitaires. Un épisode marquant en 2017 d'une forme pulmonaire de la maladie avait déjà mis en lumière l’urgence de meilleurs dispositifs de prévention.
Contrer la peste exige de comprendre ses mécanismes de transmission. L’équipe menée par Antoine Brault et Simon Cauchemez, en collaboration avec Fanohinjanaharinirina Rasoamalala de l’Unité de Peste de l’Institut Pasteur de Madagascar, a développé des modèles mathématiques pour mieux comprendre comment les variations du nombre de rats et de puces au cours de l’année pouvaient expliquer la saisonnalité des épidémies de peste chez l’homme. Les scientifiques se sont appuyés sur des relevés de terrain minutieux : captures simultanées de rats et de puces, analyses sérologiques et suivis de populations animales, au cœur des zones endémiques malgaches.
L’influence des saisons sur la transmission de la peste par les puces et les rats
Les puces sont les principaux vecteurs de Yersinia pestis, l’agent pathogène de la peste. Les populations de rats et de puces connaissent des fluctuations importantes selon les saisons. Pendant la saison des pluies, la nourriture est moins abondante. Cela favorise la diminution des populations de rats. Concomitamment, lors de la saison humide le climat est favorable à l’augmentation des populations de puces à l'intérieur des maisons.

Pendant la saison sèche, les ressources alimentaires plus abondantes, ce qui entraîne une augmentation du nombre de rats. « Grâce à notre large collecte de données, on a pu observer que la densité de puce augmente sur les rats alors même que les populations de rats diminuent. » affirme Fanohinjanaharinirina Rasoamalala. « Ainsi, même si la population de rat diminue, du fait de l’augmentation du nombre de puce, le risque de transmission à l’humain est plus élevé durant la saison humide. »
Nécessité d’une démarche One Health
La peste ne se limite pas à une maladie humaine : elle s’inscrit au cœur des interactions entre faune, flore, climat et sociétés humaines. L’approche dite One Health prônée par l’ensemble des équipes du projet vise à prendre en compte cet enchevêtrement. L’étude démontre ainsi comment des interventions ciblant simultanément les populations de rats et de puces, à des périodes clés entre juillet et septembre, avant le pic épidémique), pourraient réduire de façon significative le risque de flambées épidémiques. La compréhension des liens entre santé humaine, animale, environnementale permet d’envisager un contrôle durable d’une maladie qui reste, chaque année encore, une menace avec des effets à la fois d’un point de vue sanitaires mais aussi socio-économiques.
Un modèle pour contrer la peste et ses variations
Le modèle mathématique a pu être développé grâce à un travail interdisciplinaire combinant des relevés de terrain à une surveillance sanitaire. Il intègre une grande quantité de données collectées sur plusieurs années et exploite la puissance d’un supercalculateur pour les analyser. Il s’est révélé particulièrement performant même en utilisant des données hétérogènes, combinant les dynamiques de population des rats et des puces, interprétées dès le début de la saison.
Comprendre ces variations saisonnières permet de mieux cibler les périodes à haut risque et d'adapter la surveillance ainsi que les interventions de lutte contre les puces et les rats. Ces résultats pourraient favoriser la mise en place de stratégies préventives sur le terrain, en collaboration étroite avec le Ministère de la santé malgache et les communautés locales. Des recommandations opérationnelles sont alors prêtes à être testées et adaptées localement. Passer de l’intervention réactive (agir une fois l’épidémie déclarée) à l’anticipation, grâce à un système d’alerte précoce (early warning system par exemple), est l’ambition affichée. Cela nécessitera d’affiner le modèle pour tenir compte des facteurs climatiques, agricoles et sociaux.
Ce projet des équipes de l’Institut Pasteur Paris a été mené à bien grâce à l’implication et au soutien de l’Institut Pasteur Madagascar, Institut de Recherche Biomédicale des Armées, l’Agence Française d’expertise technique internationale. Ce projet se distingue par un volet "formation" particulièrement fort : les scientifiques malgaches ont été formés à la modélisation mathématique des maladies infectieuses.
Référence : F. Rasoamalala, B. Ramasindrazana, M.J. Parany, S. Rahajandraibe, L. Randriantseheno, S. Rahelinirina, O. Gorgé, E. Valade, M. Harimalala, M. Rajerison, S. Cauchemez, & A. Brault, Unraveling the role of rat and flea population dynamics on the seasonality of plague epidemics in Madagascar, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (24) e2502161122, doi.org/10.1073/pnas.2502161122 (2025).